Par Florent Ly-Machabert.
S’il n’est pas question de nier que l’économiste grec, qu’on associe à la théorie de l’échange inégal entre pays riches et pauvres, fut bel et bien d’inspiration marxiste, on doit à la vérité de reconnaître que sa critique étayée des approches marxistes et néo-marxistes du sous-développement a permis à ce pan de la théorie économique de sortir de l’ornière de concepts économiques qui s’appliqueraient partout et de la même façon.
L’émergence de nations non alignées sur les modèles des blocs de l’Est ou de l’Ouest et la décolonisation forment le contexte dans lequel les théories économiques du développement tentent de bâtir un nouveau paradigme qui se propose de rompre avec trois courants : d’abord, avec la « synthèse » keynéso-classique pour le manque de réalisme de ses hypothèses ; ensuite, avec le keynésianisme lui-même, au motif qu’il ne s’adapterait pas aux spécificités institutionnelles des pays en développement ; enfin, avec le marxisme tant pour son évolutionnisme historique, qui fait du capitalisme un passage obligé, que sa négation du gain à l’échange (qu’il partage néanmoins avec le néo-marxisme).
Ce sont au final quatre grands courants qui vont voir le jour dans les années 60 : l’école traditionnelle du développement, sous l’égide des Lewis et Myrdal ; le courant structuraliste, version latino-américaine (Prebisch) ou version française (Perroux), qui considère le monde comme rigide à court et moyen termes du fait de l’inertie des structures sur lesquelles le changement doit donc porter prioritairement pour sortir du sous-développement ; le néo-marxisme des deux Paul (Baran et Sweezy) qui va progressivement converger vers les courants précédents, notamment devant la question du surgissement des monopoles qui va les convaincre de substituer le concept de surplus à la loi marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit et la lutte des peuples à celle des classes ; et enfin la théorie de la dépendance, qui voit dans la domination de la modernité occidentale la cause du sous-développement et suggère, pour résoudre ce dernier, de tenir compte, avec Cardoso et Faletta, des facteurs sociopolitiques ou, avec Frank et Amin, de facteurs externes comme la colonisation, démarche qui projette les « dépendantistes » vers un programme radical de déconnexion vis-à-vis du système capitaliste mondial et de développement beaucoup plus auto-centré.
Mais plusieurs comètes vont ensuite venir bousculer cette galaxie de l’économie du développement aux concepts formels, nés de l’observation des faits – ou plus normatifs – et censés s’appliquer de la même façon à tous les pays développés ou moins avancés, au mépris de la singulière histoire des nations ; et parmi ces modèles alternatifs, le plus fécond est probablement celui de l’économiste grec Arghiri Emmanuel, connu pour ses écrits de 1969 : “L’échange inégal”.
Dans cette œuvre, Emmanuel propose en effet un dépassement du dilemme léninien du début du XXe siècle. entre la théorie de l’impérialisme néo-marxiste1 – selon laquelle les pays en retard doivent s’émanciper de l’ordre économique mondial pour se développer, et sa variante évolutionniste2 – qui considère le capitalisme comme un stade nécessaire. Pour ce faire, il va jeter un pont – en hétérodoxe non officiel – entre, d’une part, l’analyse structuraliste opposant un Centre (les pays industrialisés avantagés par leurs positions et leur avance technologique) et une Périphérie3 (les pays en sous-développement) et, d’autre part, l’approche ricardienne, qu’Emmanuel amende significativement en lui adjoignant deux hypothèses liées à la mondialisation : celle de la mobilité du facteur capital et celle d’une « valeur internationale » c’est-à-dire d’un prix mondial unifié, la main d’œuvre voyageant et les salaires augmentant moins vite que le facteur capital.
Arghiri Emmanuel détaille ensuite, dans ce contexte, que dans le cas des biens inexistants au Nord (et donc non substituables), seul un écart de salaire résultant d’un rapport de force politique ou économique (souvent syndical) défavorable entre les pays du Centre et ceux de la Périphérie, et qui n’a donc rien à voir avec un différentiel de productivité, peut expliquer l’inégalité de l’échange ; argument qu’Amin étendra au cas des biens identiques entre Nord et Sud, pour lesquels l’échange inégal peut alors provenir d’un écart de productivité plus faible que l’écart salarial.
Cette démonstration conduira progressivement Emmanuel à s’ériger en passeur pour tirer toute l’économie du développement des ornières conceptuelles dans lesquelles elle sombrait courant après courant : il va rejeter en bloc les thèses dépendantistes de l’autonomie industrielle, les pays périphériques pouvant parfaitement s’industrialiser grâce aux transferts de technologie opérés par les firmes multinationales (on trouve sous sa plume l’éloquente citation suivante : « On a la dépendance de son sous-développement et non le sous-développement de sa dépendance. ») ; avant de procéder à la contestation méthodique de l’approche culturaliste de la dépendance technologique, comme en atteste sa déclaration : « On a la culture de sa technologie et non la technologie de sa culture […] une technologie pour les pays pauvres serait une pauvre technologie. »
De fil en aiguille, et probablement sans en avoir une claire conscience dans les années 70, Arghiri Emmanuel sauve de l’engloutissement sous les thèses marxistes et néo-marxistes tant la théorie ricardienne des échanges internationaux, à commencer par le gain à l’échange, que l’approche structuraliste du développement, en ouvrant la voie, d’abord, à la thèse de l’interdépendance Nord/Sud (qu’illustre le renforcement de l’OPEP qui a obligé l’Occident à prendre en compte les revendications de hausse des prix du cartel), prétexte hélas, dans ses écrits, à un triple contrôle des flux financiers des multinationales, des raccourcis technologiques et de la localisation des filiales ; puis à l’économie-monde de Wallerstein qui dépasse la dichotomie Nord/Sud au bénéfice d’une hiérarchisation holiste de l’espace économique mondial, vouant par là définitivement à l’échec toute stratégie de rupture avec le Centre mais offrant aussi d’heureuses opportunités de glissements, certes lents, dans le classement des nations.

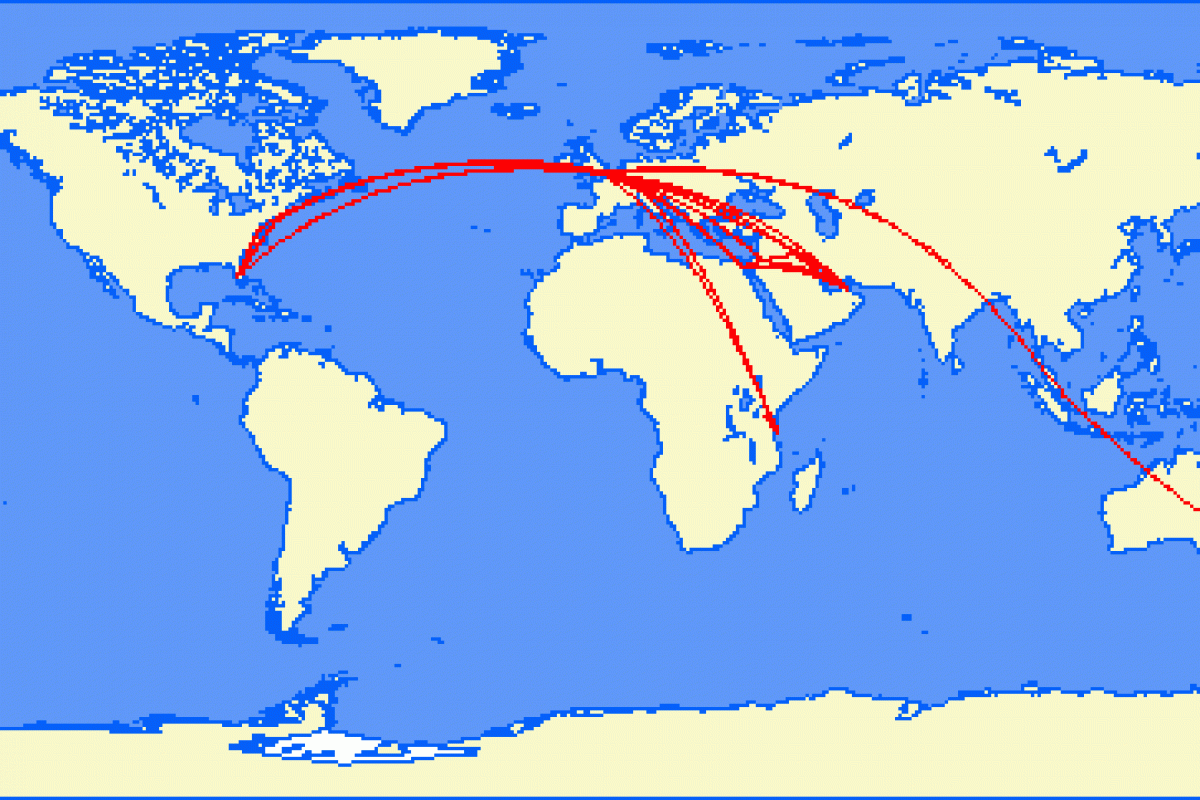


Frank, pas “Franck”, André Gunder Frank.